 |
| "Deep Autumn", 1972 / Yamaguchi Kayo |
De la démocratie au Japon
-Vers une participation en concertation ?-
Par Patricia Marmignon
Par contraste au droit contractuel français qui repose sur le droit de l’individu, au Japon, il s’agit traditionnellement d’une collaboration fondée sur une morale confucéenne, dans un système globalisant hiérarchisé intégrant les communautés de quartier (chônaikai). Le développement simultané d’associations (komyuniti) est assez récent. Elles apparaissent à la fin des années 1960, et fleurissent depuis le séisme de Kôbe de 1995. À fortiori, le développement du droit juridique est de plus en plus marqué. Mais, si cette tendance semble à priori représenter un pas vers une reconnaissance du droit de l’individu dans les processus de décision relatifs à l’urbanisation, qu’en est-il depuis le 11 mars ?
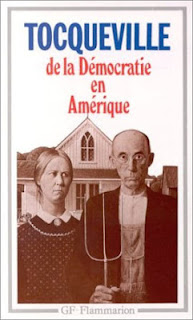 |
| Alexis de Tocqueville De la démocratie en Amérique, 1835 (Édition Flammarion, 1993) |
Pour Nishi Amane (1829-1897) qui introduit la sociologie au Japon à la fin des années 1870, seule la société de type Gemeinschaft (communauté) où il y a interdépendance entre humains (ningen) a une résonance. Selon Tönnies (1887), la société de type Gemeinschaft est établie sur l’identité substantielle des volontés assimilées, alors que la société de type Gesellschaft (société) est fondée sur la stricte individualité des intérêts. Or, la socialité japonaise repose sur un grégarisme holiste développé à partir des anciennes communautés rurales, mura, de type coercitif, ce qui correspond au type Gemeinschaft dans son principe global où les individus se fondent en une totalité par opposition à celle de type Gesellschaft où ce sont les intérêts personnels qui orientent les comportements.
Traditionnellement, le tout intégrateur naît d’un idéalisme moral issu du confucianisme (jukyô), par les rites et la vertu d’humanité. L’ordre social est garanti par les vertus d’affection entre père et fils, de correction entre prince et sujet, de distinction entre époux, d’ordre entre aîné et cadet et enfin de sincérité entre amis (Ansart, 1998). La morale se diffuse aussi par des préceptes (kakun) représentant les principes de la vie quotidienne familiale.
« À la manière des maisons de bois qui grincent et plient sans se rompre lorsque passe le typhon ou que la terre tremble, la société pré-moderne japonaise était solidement charpentée. D’un côté la tradition confucéenne (...) de l’autre, le principe de l’ie (la maison). »
Christian SAUTTER (1990), p.16.
Cet ordre se renforce dans les années 1880, avec l’introduction du droit naturel dans un pays de droit coutumier, par Gustave-Émile Boissonade (1825-1910). Le droit naturel, qui se fonde sur la nature de l’homme, sur une morale plus que des codes, a été opposé au droit positif, lequel par opposition signifiait la règle édictée par l’autorité compétente et assignée à la contrainte juridique. En dehors du contexte positiviste, il est cependant plus judicieux de parler de droit juridique en vue d’un certain passage de la métaphysique à la phénoménologie (Marmignon, 26/05/2011).
Depuis Meiji (1868), le système englobant part de l’empereur, souverain déifié, et s’appuie sur l’ie (maison) issue de cette lignée, les communautés de quartier (chônaikai), les communautés religieuses et l’entreprise (Marmignon, 2010 (thèse 2008)). Ces communautés englobantes intégrant les individus, dans une vision holiste, sont les kyôdôtai, avec l’empereur, Tennô, à leur tête, lui-même descendant du couple de Kami (Dieux) primordial, créateur du pays.
 |
| "Une architecture plurielle: la maison du chat noir", Tokyo, Bunkyô-ku ((cc) Patricia Marmignon, 2001) |
Avant la Seconde Guerre mondiale, le droit coutumier à partir des rites, et le droit naturel à travers un système pyramidal hiérarchisé font jurisprudence au Japon. Par contraste, le droit juridique n’est qu’embryonnaire, y compris en matière d’urbanisme. Permissif et rudimentaire, il n’a que peu d’impact sur les développements urbains. Cela se retrouve à l’échelle architecturale où un éclectisme prédomine, à l’inverse de nos alignements haussmanniens ou de nos toits rouges. Et, si cela démontre, a contrario, la présence d’une certaine démocratie participative au Japon, celle-ci est englobée dans un système identitaire, à travers les rites, les usages et le jeu interactionnel entre acteurs, le mode opératoire (Marmignon, 26/05/2011).
La déclaration de Potsdam de 1945 ouvre cependant le Japon à une tendance démocratique et au respect des droits de l’individu. C’est à cette époque que le concept de jiyû (liberté), perçu jusqu’alors « par les Japonais comme le droit de faire n’importe quoi à sa guise dans la vie privée », prend son sens moderne et constitutionnel de « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (Fukase, 1990). Ce changement est d’abord marqué par la nouvelle Constitution du Japon (Nihon-koku-kempô), promulguée en 1946 et mise en vigueur le 3 mai 1947, qui adopte les principes fondamentaux de la souveraineté populaire. Il se traduit aussi par une relative évolution des communautés de quartier (chônaikai), et l’apparition d’associations (komyuniti).
2. L’embrayage droit naturel/droit juridique :
les communautés de quartier (chônaikai) et les associations (komyuniti)
les communautés de quartier (chônaikai) et les associations (komyuniti)
 |
| "Un ordre social", Tokyo ((cc) Patricia Marmignon, 2000) |
Les communautés de quartier (Marmignon, 28/01/11) représentent le système emblématique de la participation des habitants au Japon. Elles sont liées par l’habitat et l’habiter et sont un produit de la modernité dont l’unité est l’ie, la maison. Elles ne sont point fondées « sur la libre association d’individus égaux visant un but précis, mais sur un collectivisme diffus niant l’individu » (Berque, 2004). Issues des groupes unis pour la protection du voisinage qui se sont formés dès le XVe siècle au sein des chô (quartiers), les communautés de quartier (chônaikai) prennent leur envol dans les grandes villes, après le grand séisme du Kantô de 1923. En 1924 sont alors établis les procédés réglementaires des conseils (chôkai kiyaku yôryô) qui vont réguler les chô, des groupes unis pour la protection du voisinage, la reconstruction, l’information, l’assistance et la sécurité. En 1940, l’étatisation des communautés de quartier se fait radicalement, avec en leur sein des groupes de voisinage de dix maisons (tonarigumi). Et en 1947, elles sont « abolies » par la proclamation du quinzième article du décret de Potsdam, car considérées comme anti-démocratiques.
Relancées par le traité de paix en 1952, les chônaikai transmettent, collaborent et organisent (Iwasaki, 1989). Elles impliquent la plupart des habitants. Leurs fonctions sont diverses. Elles concernent la sécurité, la cogestion des équipements et du patrimoine du quartier, comme la gestion et l’entretien de la voirie, des espaces verts, de l’éclairage public, l’information ou l’organisation de fêtes locales, encore que cela varie selon les régions. Cela est plus vrai à Kyôto, ancienne capitale et faite de tradition, qu’à Tokyo. Elles sont à l’origine de conventions restrictives relatives à la construction, de conventions architecturales (kenchiku kyôtei). La préservation, de la sécurité et du paysage, est ainsi assurée (Takamura, 2009). Leur rôle, qui pouvait relever de l’enquête ou de l’audience publique, s’élargit aujourd’hui et s’institutionnalise par un débat public dans l’élaboration d’un plan local ou des décisions politiques. Leurs activités évoluent aussi vers l’aide aux personnes âgées, aux handicapés, et la gestion des déchets.
Depuis 1968, les communautés de quartier peuvent être également relayées par, ou former certains ponts avec des « associations » (komyuniti) (Marmignon, 2010 (thèse 2008)). Le terme komyuniti que l’on peut traduire par association en s’en référant à MacIver (1917), prend en compte à la fois la part individuelle et la part sociale de l’« être social ». Apparu en 1968, c’est une reprise des mouvements d’habitants (jûmin undô) par le gouvernement. Le premier texte gouvernemental abordant cette notion, traitant de la formation de komyuniti, est celui d’une consultation à une réunion d’enquête de l’assemblée délibérante de la vie nationale (kokumin seikatsu shingi-kai chôsa bukai) auprès du Premier ministre Satô Eisaku (1901-1975), en janvier de la 43e année de Shôwa (1968). Cette discussion est intitulée « Des mesures afin d’assurer une vie saine au peuple en réponse aux conditions en mutation qui accompagnent l’essor de croissance dans la société économique » (Takemura, 1978).
Au cours de cette réunion, la question de la formation de komyuniti est examinée selon une problématique tripartite concernant la vie du peuple à long terme, les personnes âgées et les loisirs. De là est formé un comité restreint (shô-iinnkai) sur la question des komyuniti, qui publie en 1969 des bulletins (hôkokusho) sur ce sujet, bulletins officiels des premières komyuniti au Japon. Dans ces bulletins, l’on traite de la nécessité de komyuniti, de mesures pour les former et de l’effondrement, en parallèle, des communautés locales (chiiki kyôdôtai).
Cette nouvelle branche relève du local, de l’international, de l’urbain, de l’innovation, de l’habiter et de l’être social en tant qu’organisme incorporant à la fois la dimension individuelle et sociale. Elle s’est particulièrement développée depuis le séisme de Hanshin-Awaji de 1995, dit communément séisme de Kôbe. L’autonomie des habitants (jûmin jichi) et le volontariat (borantia katsudô) émergent, institutionnalisés depuis les années 1990-2000. En 1998, la loi sur les associations - qui équivaut à la loi de 1901 en France -, la loi NPO est promulguée. Elle vient reconnaître comme personnes morales ces nouveaux acteurs. Elle facilite la participation, mais ne démontre pas forcément d’une autonomie puisque des subventions sont accordées par la municipalité.
 |
| "Le Mont Fuji vu au-dessus des vagues", Hokusai des Cents vues du Mont Fuji, éd. par Nishimuraya Yohachi, 1835 (Leiden, National Museum of Technology) |
On peut parler véritablement d’un tournant vers une autonomie locale encadrée par un système juridique croissant, à partir de 1968. Outre l’apparition de komyuniti, et l’utilisation dans certaines régions de jichikai (communauté autonome) plutôt que chônaikai (communauté de quartier), la nouvelle loi d’urbanisme (Shin-toshikeikaku), qui distingue les terrains urbanisables de ceux à contrôler, introduit l’audience publique (kôchôkai) (Marmignon, 8/09/2011). Autrement dit, les personnes concernées et intéressées peuvent donner leur avis aux autorités locales en ce qui concerne les plans d’urbanisme municipaux et départementaux. Cette participation est cependant limitée car il n’existe pas de règle obligeant l’autorité administrative à organiser une procédure de participation au cours du projet, et ne concerne que les effets environnementaux, jamais les effets socio-économiques (Watari, 2007).

