 |
| Chant of Universe, Bang, Hai Ja (1975) (source) |
Paru dans Guy MERCIER, Les territoires de la mondialisation, Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 73-91. Table ronde Les territoires de la mondialisation . Salon international du livre, Québec, 25 avril 2002
La mondialisation a-t-elle une base ?
par Augustin BERQUE
1. Monde n'est plus univers, ni cité humaine
Seraient-ils les plus rebattus, les mots ont toujours
des profondeurs insoupçonnées ; c'est à nous d'aller y voir, en commençant par
les dictionnaires. Ainsi l'édition 2001 du Petit
Larousse illustré définit-elle mondialisation
comme « Fait de devenir mondial, de se mondialiser ; globalisation » ; et mondial comme « ce qui concerne le monde
entier » . Fort bien ; mais alors,
qu'est-ce donc que le monde ?
Le Petit Larousse recense treize acceptions de ce terme, la première étant « Ensemble de tout ce qui existe ; univers ». Le bât blesse déjà ; car univers, de son côté, se trouve également défini comme « Le monde entier ; l'ensemble de ce qui existe » ; avec il est vrai l'ajout d'une parenthèse troublante : « Dans le sens astronomique, prend une majuscule ». Le monde quant à lui jouit bien de quelques usages avec majuscule - comme par exemple dans l'Ancien Monde, le Nouveau Monde -, mais il n'a pas droit, en 2001, aux égards de l'astronomie. Celle-ci est une science exacte ; et si elle envisage bien, sous le nom de Big Bang, une naissance de l'Univers, cela n'a rien à voir avec ce que la tradition nommait la création du monde, et moins encore avec le titre (apocryphe?) d'un tableau fameux de Gustave Courbet, L'Origine du monde. Il y a là, entre le monde et l'univers, une divergence radicale. Elle n'est autre que ce qui sépare la vision scientifique de la vision mondaine.
Le Petit Larousse recense treize acceptions de ce terme, la première étant « Ensemble de tout ce qui existe ; univers ». Le bât blesse déjà ; car univers, de son côté, se trouve également défini comme « Le monde entier ; l'ensemble de ce qui existe » ; avec il est vrai l'ajout d'une parenthèse troublante : « Dans le sens astronomique, prend une majuscule ». Le monde quant à lui jouit bien de quelques usages avec majuscule - comme par exemple dans l'Ancien Monde, le Nouveau Monde -, mais il n'a pas droit, en 2001, aux égards de l'astronomie. Celle-ci est une science exacte ; et si elle envisage bien, sous le nom de Big Bang, une naissance de l'Univers, cela n'a rien à voir avec ce que la tradition nommait la création du monde, et moins encore avec le titre (apocryphe?) d'un tableau fameux de Gustave Courbet, L'Origine du monde. Il y a là, entre le monde et l'univers, une divergence radicale. Elle n'est autre que ce qui sépare la vision scientifique de la vision mondaine.
Cette divergence entre le monde et l'univers
n'existait pas autrefois ; elle s'est amorcée avec la révolution copernicienne,
et depuis n'a fait que s'agrandir. Pour la philosophie, qui dès ses origines a
beaucoup discuté du concept de monde[1], une
distinction s'est imposée du même pas entre monde objectif et monde subjectif.
Toutefois, il est dans la nature du monde que le sens commun ne fasse pas cette
distinction ; et c'est bien ce que reflètent, dans le Petit Larousse, les définitions premières qui sont données de monde et d'univers. « L'ensemble de ce qui existe », cela comprend
nécessairement notre propre existence ; et non moins nécessairement, celle-ci
est subjective. Pour le sens commun, cela n'exclut pas les choses même les plus
objectives ; mais la science, elle, considère qu'il y a une incompatibilité
radicale entre le subjectif et l'objectif. Aussi, depuis Descartes, a-t-elle dû
abstraire l'un de l'autre ces deux aspects de la réalité. Pour le fondateur du
dualisme moderne, c'était la condition de ce qu'il appelait la « science pure
», c'est-à-dire sans rapport avec le « sentiment » (la faculté de
sentir), dans lequel néanmoins il voyait l'expression même de notre vie[2] ;
mais pour nombre de ses descendants, moins certains du fondement métaphysique
de la subjectivité, le monde objectif est apparu peu à peu comme la réalité
tout court, tandis que le monde subjectif - pourtant celui de l'existence -
était renvoyé à l'illusion, une illusion forcément seconde. Ce n'est qu'au XXe
siècle que Heidegger, renversant la perspective, a montré que la réalité
première est existentielle, mondaine (weltlich)
et, comme telle, close par un horizon, tandis que la dimension objective est
une abstraction seconde[3] -
celle au premier chef de l'étendue cartésienne (extensio), mais non moins l'espace absolu de Newton, homogène,
isotrope et infini, dans lequel il y aurait secondement les choses. Pour
Heidegger, il y a d'abord les choses, dans la « contrée » (Gegend) de l'existence.
Le renversement heideggérien n'est pas une révolution
copernicienne à l'envers, autrement dit nous ramenant au monde ptoléméen qui
avait précédé la vision scientifique moderne. En effet, ce renversement est
contemporain et homologue d'un autre renversement, qui, lui, porte sur
l'univers et touche aux paradigmes de la science même : la théorie de la
relativité einsteinienne, restreinte (1905) puis générale (1915), qui fonde et
structure la cosmologie actuelle, c'est-à-dire notre conception de l'Univers
(mais non plus du monde, comme autrefois). L'homologie en l'affaire est que,
dans ce cadre, l'espace-temps n'est plus infini et neutre : il a pour ainsi
dire un horizon (le « bord » de l'univers, comme on dira plus tard), et il se
courbe en fonction de la matière : « La courbure dit à la matière comment se
mouvoir, et la matière dit à l'espace-temps comment se courber[4] » ;
tandis que de son côté, dans le monde historial[5] de
Heidegger, l'espace mondain est fonction de l'œuvre humaine, laquelle le
déploie (elle « spacie », räumt) à
partir de son site (Ort), au lieu,
comme dans la conception moderne-classique (celle de Descartes et de Newton),
de n'avoir qu'une position (Stelle)
dans une étendue neutre, universelle et objective[6]. Et
ce déploiement dans l'espace est aussi un processus qui se déroule dans le
temps : une Räumung (spaciation),
comme l'écrit Heidegger. Pour autant que les œuvres sont matérielles, c'est là
dire quelque chose d'assez voisin de ce qui se passe dans l'Univers einsteinien
; et dans l'un comme dans l'autre cas, on est là aussi loin de l'espace et du
temps absolus de la cosmologie newtonienne que de ce pur espace (reiner Raum) qu'est l'extensio cartésienne. On est dans un
autre monde… ou plutôt, l'on devrait y être! Car en réalité, notre vision du
monde est encore largement déterminée par le paradigme moderne-classique ; et
c'est dans cette inadéquation que le bât blesse. En effet, cela prive notre
monde de toute cosmicité,
c'est-à-dire de tout sens fondé en physique et en morale : inadéquat à la
cosmologie scientifique non moins qu'à la philosophie de l'existence, il va son
chemin sans justification possible.
C'est en effet dans un manque foncier de cosmicité que
se développe la mondialisation actuelle. Le « monde » que l'on y considère n'a
certes, semble-t-il, pas grand chose à voir avec Einstein, ni avec Heidegger,
puisqu'il s'y agit essentiellement de marché ; mais c'est justement du fait de
ce manque de cosmicité - de ce manque de fondation dans la physique des choses
comme dans les principes de l'existence humaine - qu'il nous semble que les
affaires de marché peuvent s'abstraire des fondements de l'existence comme de
ceux de la physique. Autrement dit, que notre monde peut aller son chemin sans
base, pour lui-même - ou plus justement, dans le seul intérêt du système qui le
domine. Plus clairement encore : dans le seul intérêt de ceux qui dominent ce
système. Or que par exemple même un géographe peu suspect de dérapages
cosmologiques ou existentialistes, comme Pierre Merlin, ait pu intituler le
chapitre qu'il consacre à ce sujet dans son dernier livre : « La mondialisation
: négation des territoires »[7], cela
révèle que le système en question tend à imposer un espace indifférent à la
diversité naturelle et culturelle de la Terre, et de ce fait, adverse à ce qui
engendre cette diversité : le fonctionnement de la biosphère comme les
identités collectives, ces cadres historiques de toutes nos morales, de toutes
nos coutumes. Et c'est par là que la mondialisation actuelle, dans sa tendance
dominante, est bien aussi - mais au plus profond - un processus de décosmisation[8].
Ce que nie en effet la mondialisation, en imposant
cette métaphore d'extensio cartésienne
qu'est l'espace unique du marché, ce ne sont pas seulement les frontières
économiques et culturelles des territoires de la tradition ; c'est la structure foyer-horizon par laquelle
pouvaient coexister, autrefois, différents mondes à la surface de la Terre.
Cette structure, c'est ce qui, dans le mundus
des Romains comme dans le tianxia («
sous-le-ciel ») des Chinois, établissait la coïncidence cosmologique,
nécessaire à l'existence humaine, entre les lois de la nature et celles de la
société, le cours des astres et les comportements. Tous les mondes prémodernes,
chacun à sa manière[9],
ont établi cette coïncidence (autrement dit, leur horizon). Le cas des rites de
fondation romains (hérités des Étrusques) est particulièrement éclairant, parce
qu'il nous a justement laissé, avec le terme même de mundus (devenu en français « monde »), les recettes par lesquelles
on pouvait faire coïncider, en toute cité, le nombril du monde et le
commencement de l'histoire[10] ;
c'est-à-dire justifier l'espace-temps concret de l'existence. Mutatis mutandis, toutes les traditions
humaines ont possédé de tels rites, parce qu'elles ont toutes possédé un monde,
avec chacun son foyer comme son horizon. De cela il nous reste, notamment, les
territoires nationaux que nous a légués l'histoire, avec non seulement leurs
capitales et leurs frontières, mais leur capacité de définir encore la loi de
la cité. Cela qui, sous nos yeux, achève de se défaire.
2. L'ordre-monde
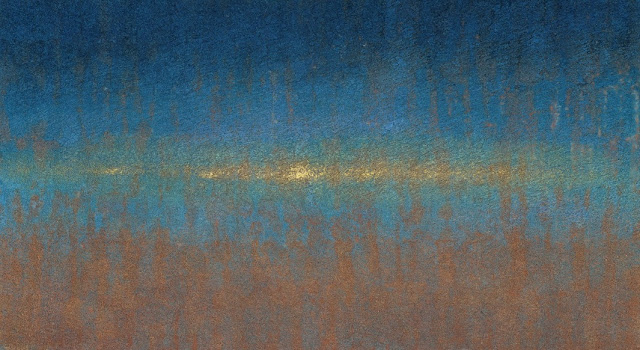 |
| Light of the Earth, Bang, Hai Ja (2006) (source) |
Cet ordre que nous achevons de perdre, l'ordre-monde à
la fois cosmique et mondain[11] qui
réglait autrefois l'existence en deçà d'un horizon, sur quoi se fondait-il ?
Les deux philosophes qui au XXe siècle ont le plus directement posé
la question, Nishida Kitarô (1870-1945) et Martin Heidegger (1889-1976), ont à
cet égard des vues à la fois parentes et inconciliables.
C'est
dans L'Origine de l'œuvre d'art[12] que
Heidegger expose sa conception de l'« installation » (Aufstellung) de monde, à partir de l'exemple fameux du temple grec
:
Debout sur le roc, l'œuvre qu'est le temple ouvre un
monde et, en retour, l'établit sur la terre, qui, alors seulement, fait
apparition comme le sol natal (heimatlicher
Grund). (p. 45)
Être-œuvre signifie donc : installer un monde. Mais
qu'est cela, un monde ? (…) Un monde, ce n'est pas le simple assemblage des
choses données, dénombrables et non dénombrables, connues ou inconnues. Un
monde, ce n'est pas non plus un cadre figuré qu'on ajouterait à la somme des
étants donnés. Un monde s'ordonne en
monde (Welt weltet[13]), plus étant que le palpable et que le
préhensible où nous nous croyons chez nous. Un monde n'est jamais un objet
consistant placé devant nous pour être pris en considération[14]. Un
monde est le toujours inobjectif sous la loi duquel nous nous tenons, aussi
longtemps que les voies de la naissance et de la mort, de la grâce et de la
malédiction nous maintiennent en l'éclaircie de l'être. Là où se décident les
options essentielles de notre Histoire, que nous recueillons ou délaissons, que
nous méconnaissons ou mettons à nouveau en question, là s'ordonne un monde. (p.
47)
Bien que la réflexion de Heidegger se soit donné pour
objet l'œuvre d'art, il est clair qu'il s'agit de l'œuvre humaine en général,
elle-même inséparable de la condition ou de la spécificité de l'être humain. En
effet,
Une pierre n'a pas de monde. Les plantes et les
animaux, également, n'ont pas de monde, mais ils font partie de l'afflux voilé
d'un entourage qui est leur lieu. (pp. 47-48)
C'est ainsi le propre de l'humain que d'ouvrir des
mondes, par ses œuvres. Pour dire cette opération, Heidegger use de métaphores
archaïques, peut-être même volontairement sibyllines ; ce qui ne permet
pas de l'identifier avec certitude. Peut-être aussi Heidegger n'a-t-il pas
lui-même identifié cette opération, qui apparaît pour le moins ambiguë. Il est
clair néanmoins que, pour lui, l'œuvre agit dans un double sens : d'un côté,
elle ouvre un monde à partir de la terre, de l'autre elle établit la terre
comme telle dans la mesure même où elle ouvre un monde à partir de la terre :
Ce vers où l'œuvre se retire, et ce qu'elle fait
ressortir par ce retrait, nous l'avons nommé la terre. Elle est ce qui, ressortant,
reprend en son sein (das
Hervorkommend-Bergende). La terre est l'afflux infatigué et inlassable de
ce qui est là pour rien. Sur la terre et en elle, l'homme historial fonde son
séjour dans le monde. Installant un monde, l'œuvre fait venir la terre (Indem das Werk eine Welt aufstellt, stellt
es die Erde her). Ce faire-venir doit être pensé en un sens rigoureux.
L'œuvre porte et maintient la terre elle-même dans l'ouvert d'un monde. L'œuvre libère la terre pour qu'elle soit
une terre. (pp. 49-50)
Ainsi, le rapport entre terre et monde, que Heidegger
qualifie de « litige » (Streit), ne
s'achève-t-il jamais dans la victoire de l'un des deux termes. Indéfiniment, la
terre et le monde se supposent l'un l'autre :
Monde et terre sont essentiellement différents l'un de
l'autre, et cependant jamais séparés. Le monde se fonde sur la terre, et la
terre surgit au travers du monde. Cependant, la relation entre monde et terre
ne décrépit point en une vide unité d'opposés qui ne se concernent en rien.
Reposant sur la terre, le monde aspire à la dominer. En tant que ce qui
s'ouvre, il ne tolère pas d'occlus. La terre, au contraire, aspire, en tant que
reprise sauvegardante, à faire entrer le monde en elle et à l'y retenir. (pp.
52-53)
Sans pouvoir prendre position - car c'est affaire
d'historiens de la pensée - dans le débat ouvert par Reinhard May à propos des
influences orientales, et plus particulièrement japonaises, dont Heidegger se
serait inspiré sans le dire[15], il
me semble que cet énigmatique litige de la terre et du monde s'éclaire
singulièrement si on le rapproche du rapport sujet/prédicat tel qu'il apparaît
dans la philosophie de Nishida. Mais rappelons-nous tout d'abord que le sujet, subjectum en latin, c'est
étymologiquement « ce qui est mis dessous ». Subjectum traduisait le terme aristotélicien hupokeimenon, dont l'étymologie signifie également « ce qui est mis
dessous ». Il n'est pas fortuit que cette image première soit également celle
dont nous vient substance (de substantia, terme lui-même homologue du
grec hupostasis: « le fait de se
tenir dessous ») ; car pour Aristote, père de la logique, le sujet, c'est
l'être substantiel (ousia), tandis
que le prédicat - ce qui est dit du sujet - n'existe pas vraiment[16]. Il
n'est pas fortuit non plus que l'on puisse lire, chez un orateur comme
Isocrate, cette expression : « toute la terre étendue sous le ciel » (hê gê hapasê hê hupo to kosmô keimenê)[17] ;
car l'hupokeimenon, l' « étendu-sous
» premier de tout discours humain, c'est bien la terre avec ce qu'elle porte.
La même expression nous révèle que ce qui s'impose ainsi, mettant de l'ordre (kosmos) dans les choses de la terre,
c'est le ciel. Il n'est en effet pas fortuit, non plus, que kosmos ait signifié à la fois l'ordre,
le ciel et le monde - ce qui fait dire à Platon, dans la phrase qui conclut le
discours onto-cosmologique du Timée,
« le Monde est né : c'est le Ciel qui est un et seul de sa race » (ho kosmos […] gegonen heis ouranos hode
monogenês ôn)[18] ;
car tout cela découle de la métaphore première par laquelle l'être devenant
humain, se dressant les pieds sur la terre et la tête vers le ciel, du même
mouvement qu'il acquérait la parole et la technique[19],
découvrit l'horizon : le trait délimitant qui, séparant le ciel de la terre,
instaurait parmi les choses l'ordre d'un monde humain.
Toutefois,
si les images dont procèdent les mots de notre philosophie permettent ainsi
d'assimiler la terre au sujet, l'assimilation du monde à un prédicat s'est
faite ailleurs : en Asie orientale, dans la « logique du lieu » (basho no ronri) de Nishida Kitarô[20].
Celui-ci fut guidé par l'idée d'opposer à l'identité du sujet (shugo) - principe directeur de la
logique aristotélicienne - celle du prédicat (jutsugo), qui pour lui est un « lieu » (basho) où le sujet « s'engloutit » (botsunyû suru). En ce sens, le prédicat nie l'être du sujet ; il
est un « néant relatif » (sôtaimu),
qui va s'approfondissant pour finir, en se niant lui-même, en « néant
absolu » (zettai mu) ; négation
de soi qui, pour Nishida, est la source de l'être. Ce primat du néant sur les
êtres substantiels doit beaucoup à la notion bouddhique traditionnelle de Vide
(kû en japonais, mot qui s'écrit avec le même sinogramme que « ciel », sora). La philosophie de Nishida
concevra ensuite le monde historique (rekishi
sekai) comme lieu de tous les lieux, prédicat de tous les prédicats,
c'est-à-dire comme un absolu de nature néantielle :
Qu'il comprenne indéfiniment cette auto-négation (jiko hitei), c'est justement pour cette
raison que le monde existe de par lui-même (sore
jishin ni yotte ari), qu'il se meut de par lui-même, et qu'on peut le
considérer comme existence absolue (zettaiteki
jitsuzai). (NKZ, XI, p. 457)
D'un point de vue très général, cette philosophie
apparaît comme une absolutisation de la relationalité. Elle professe, autrement
dit, que la relation précède l'en-soi de la substance. Cette vue est construite
à l'aide d'une série de concepts, dont le plus remarquable à cet égard est l' «
auto-identité absolument contradictoire » (zettai
mujunteki jiko dôitsu). Cela revient à dire que l'altérité contradictoire
est inhérente à toute chose, et que par conséquent la relation à autre chose
devient inutile à la relation même qui fonde l'existence des choses :
Toute chose se détermine elle-même sans base (mukiteiteki ni jiko jishin wo gentei suru),
c'est-à-dire qu'elle tient son être propre (jiko
jishin wo motsu) de son auto-détermination même. (NKZ, XI, p. 390)
Cette
« absence de base » (mukitei) vaut,
par excellence, pour le monde lui-même, qui est le lieu de toutes les
relations. Nishida parle ainsi de l' « auto-détermination du monde » (sekai no jiko gentei), ce qui est en
même temps sa proprioception ou son éveil à soi (jikaku). Ainsi le monde est une prédication qui s'établit
d'elle-même, sans que lui préexistent ni hupokeimenon
ni substantia. Aussi bien, la
nécessité même qu'une action préexiste à son effet, ou un motif à son
expression, se trouve-t-elle abolie « par auto-identification contradictoire de
ce qui crée à ce qui est créé » (tsukurareta
mono kara tsukuru mono e to mujunteki jikodôitsuteki ni ; NKZ, XI, p. 391).
Ramasser
ainsi (comment faire ici autrement ?) les vues de Nishida ne pourra que
produire un effet d'exotisme oriental. Je tiens donc à souligner que cette
philosophie révèle, avant la lettre, l'essence même de ce qu'aura été le
postmodernisme dans l'histoire de la pensée occidentale, en particulier dans la
théorie derridienne du « signifiant flottant » ; à savoir un métabasisme (une répudiation de toute
base, de tout hupokeimenon, de toute substantia) laissant la mondanité se
déterminer elle-même. Certes, nos postmodernes n'ont pas poussé aussi loin que
Nishida leurs inférences ; et pour cause : héritiers du dualisme moderne, ils
ne pouvaient sinon en se ridiculisant réduire la physique à un jeu de signes.
Leur métabasisme se borne donc à une forclusion (un lockout) de la physique hors d'un monde qui se réduit à une
sémiosphère, tandis que Nishida subsume radicalement toute physique dans son
absolutisation du monde prédicatif. Il n'empêche que, serait-ce en version
mineure, le métabasisme postmoderne n'est autre qu'une expression de la logique
du prédicat identifiée par Nishida comme la logique du monde ; et le mouvement
d'une telle logique est de tendre à s'absolutiser, confondant ses propres bases
dans l'illimitation du jeu de ses prédicats :
En même temps que le plan prédicat s'illimite (jutsugomen ga mugendai to naru), le lieu
lui-même devient le vrai néant, et ce qui s'y trouve devient simple intuition
de soi-même (kore ni oite aru mono wa tan
ni jiko jishin wo chokkan suru mono to naru). (NKZ, IV, p. 288)
3. De Hiroshima au monde de Cyborg
 |
| Ciel-Terre, Bang, Hai Ja (2011) (source) |
Avec Hiroshima, la physique a eu raison du monde que
le Japon avait tenté d'illimiter ; mais à son tour, l'hégémonie américaine a
ouvert un certain monde : celui qui, pour la première fois dans l'histoire,
aura effectivement imposé ses prédicats à l'échelle de la planète entière. En
effet, à la différence du monde japonais que l'ultranationalisme ambiant, au
temps de Nishida (lequel en participait lui-même, en lui fournissant une
philosophie), fantasmait comme « le toit commun aux huit directions [de la
planète] » (hakkô ichiu)[21], le
monde américain a eu les moyens matériels de sa propre illimitation ; cependant
que, cela va sans dire, celle-ci lui était ouverte par le double suicide,
physique et moral, de l'Europe continentale dans les deux guerres mondiales du
XXe siècle.
Sentir,
penser, dire et faire : la prédication de la Terre en monde marie
nécessairement ces quatre aspects de l'existence humaine ; et c'est également
le cas de toute hégémonie, c'est-à-dire de toute imposition d'un monde par
rapport aux autres. Il va de soi, cependant, que le poids relatif de chacun de
ces quatre aspects varie selon les cas, dans la contingence de l'histoire et la
concrétude de l'écoumène[22]. Si
la tentative hégémonique du Japon - par la voie des armes, puis par celle du
marché - a échoué par deux fois au XXe siècle, c'est entre autres
raisons parce qu'elle ne bénéficiait pas, comme c'est le cas de l'hégémonie
américaine, de l'héritage britannique. Celui-ci est loin de se borner à la
langue ; il concerne les quatre aspects de la prédication humaine. On peut se
rendre compte par exemple, si l'on s'attache aux formes de l'habitat, qu'il
existe une écoumène (au sens le plus matériel de ce terme) de type anglo-saxon,
laquelle a tendu à s'imposer non seulement dans les anciennes colonies
britanniques (États-Unis compris), où elle a engendré une urbanité
particulière, mais au delà même, et cela justement à travers l'hégémonie actuelle
des modèles américains. Si d'autre part on était tenté de penser, en toute
naïveté, que c'est l'excellence même de ces modèles qui fait qu'ils se
diffusent, comme autrefois l'anglomanie, conseillons une visite au cœur de
l'ancien empire britannique : la cathédrale Saint-Paul, à Londres. Celle-ci est
sans doute, sur la Terre, le lieu de culte le plus densément investi par des
œuvres à la gloire des armées. L'on y sentira que ce n'est pas sans l'usage de
la force que s'imposent les modèles ; ni, inversement, sans la magie des
symboles. Ainsi la matière et l'esprit concourent à l'absolutisation des mondes
: si aujourd'hui l'hégémonie américaine se soutient du We are good ! bushien, comme hier celle de l'empire britannique le
faisait d'actions de grâce en Saint-Paul, c'est bien parce que sa prépondérance
relative s'abreuve au divin. L'ultranationalisme nippon des années trente, avec
son culte de l'empereur, ne faisait pas autre chose.
Cette
logique par laquelle s'absolutise le relatif, c'est bien la logique mondaine.
Il revient à la philosophie nishidienne d'en avoir montré la nature ; à savoir
que les prédicats mondains tendent à subsumer leur propre base (leur propre
sujet), pour ne plus se nourrir que d'eux-mêmes.
C'est
même doublement que l'œuvre de Nishida met à jour cette logique mondaine : à la
fois parce que, dans des écrits tels que Basho,
celui-ci montre consciemment que le prédicat « engloutit » (botsunyû suru) son sujet (i.e. le
subsume), et parce que ses écrits politiques, en faisant de l'empereur un basho (prédicat = lieu = monde = néant)
absolu, révèlent inconsciemment
l'échelle de cet « engloutissement » ; à savoir qu'il se
limite au champ prédicatif (la communauté de sens) auquel on appartient. C'est
en vertu de cette logique que tant de groupes humains se sont absolutisés en
s'appelant eux-mêmes « les Humains »[23],
comme s'ils relevaient seuls de cette condition universelle. Ce faisant, ils «
engloutissaient » l'humanité dans les termes singuliers de leur propre champ
prédicatif : leur monde engloutissait
le monde.
Si un
tel engloutissement peut s'illimiter en monde universel tout en se limitant à
un monde singulier, c'est parce qu'il est dans la nature de la logique du
prédicat de supprimer toute échelle[24].
C'est pareillement cette perte d'échelle qui fait qu'un monde, s'illimitant par
un fantasme collectif, peut se passer de base, c'est-à-dire de référence
concrète à ce qui est son hupokeimenon
: la Terre. C'est une telle dérive qui s'exprime, exemplairement, dans les
fanatismes de toute espèce ; et c'est en particulier ce qui est arrivé au Japon
des années trente, comme cela arrive, à une autre échelle et plus manifestement
encore, dans les phénomènes de sectes. Mais si de tels phénomènes apparaissent
clairement comme des fantasmes collectifs, il ne faut pas négliger de voir
qu'ils sont fondamentalement de même nature que toute mondanité, s'agirait-il
de la plus ordinaire : celle de notre propre monde.
La
divergence entre ce qui décidément relève du fantasme et ce qui relève de la
mondanité ordinaire se situe dans la mesure où la prédication perd ou garde sa
concrétude, c'est-à-dire où la logique intrinsèque du sujet n'y transparaît
plus, ou y transparaît encore. En d'autres termes, dans la mesure où un monde
garde ou non les pieds sur terre. C'est ici qu'il convient de revenir à
Heidegger, contre Nishida. L'image du Streit
entre terre et monde exprime justement que le monde, comme prédicat, ne peut
pas engloutir son sujet (la terre). Celui-ci subsiste sous le monde, comme
aporie imprédicable, c'est-à-dire comme un sol non épuisable en mondanité. La
perte d'échelle nishidienne, comme la dérive des fantasmes dans la folie, c'est
au contraire la perte de ce sol aporétique : cela qui est nécessaire pour que
l'humain continue de pouvoir se dresser les pieds sur la terre, la tête vers le
ciel.
Évoquer
une telle perte pourra laisser penser qu'il s'agit de tout autre chose que de
la réalité quotidienne de notre monde. Insistons donc, encore une fois : il est
dans la logique de toute mondanité de tendre à s'absolutiser, c'est-à-dire de
perdre ladite échelle en engloutissant son propre sujet. C'est très exactement
cette tendance qui s'exprime, au pied de la lettre, dans la crise
environnementale : le monde moderne tend à absolutiser sa propre logique en détruisant
la Terre, qui est son hupokeimenon ;
et comme l'expriment exemplairement les positions de M. Bush à ce sujet (en
refusant de ratifier les accords de Kyôto, etc.), c'est plus spécialement
l'hégémonique mondanité américaine qui s'oppose à ce que soit corrigée cette
tendance. Toutefois, si les effets écologiques de notre civilisation - plus
particulièrement dans l' « empreinte écologique » démesurée[25] de
l'American way of life - apparaissent
clairement comme une destruction de la base terrestre de notre propre
existence, il est moins évident qu'il s'agisse là de logique du prédicat. Je
terminerai donc par un exemple concret, d'ordre économique puisque le prédicat
souverain de notre monde - celui auquel nous ramenons tous les autres, et hors
des termes duquel nous ne pouvons pas concevoir de penser -, c'est bien
l'économie.
Le
moteur principal de la mondialisation contemporaine est le libéralisme de
marché. Comme tous les ismes,
celui-ci est une idéologie ; mais une idéologie concrète, inscrite non seulement
dans nos façons de penser mais dans notre mode de vie et dans les aménagements
matériels qui rendent celui-ci possible. L'un des traits de cette idéologie est
qu'elle suppose l'illimitation des besoins de l'humanité, en ce sens notamment
que de nouvelles demandes et de nouvelles offres, s'épaulant en un cercle
vertueux, ne cesseront de surgir. En pratique, il est clair que dans les pays
riches, c'est l'offre qui guide le marché, car les besoins élémentaires sont
satisfaits depuis longtemps. Il s'agit donc de créer de nouveaux besoins par
l'offre de nouveaux produits, engrenage dans lequel la publicité joue un rôle
indispensable, car c'est elle qui suscite la demande. Elle le fait en montrant
des gens satisfaits par la consommation des nouveaux produits, et que l'on rêve
donc d'imiter ; ou plus souvent - mais cela revient exactement au même - en
montrant des gens désirables qui suscitent métonymiquement le désir pour les
produits auxquels l'image les associe, produits qui en soi ne seraient pas
désirables puisqu'ils ne répondent en fait à aucun besoin préexistant. La
demande ainsi créée, la production du produit qui la satisfait peut se
développer.
Or
cette logique bizarre, dans laquelle le désir produit indéfiniment ses propres
objets, c'est exemplairement une logique du prédicat. La publicité procède en
effet selon un mécanisme dans lequel le prédicat - comme tel insubstantiel - «
est désirable » suscite son propre hupokeimenon
substantiel (par la production d'un objet quelconque). Il le suscite à
partir de son propre néant, c'est-à-dire - pour reprendre la figure nishidienne
- en produisant de l'être par sa propre négation : niée par la grâce d'une
métonymie propice, l'absence de désir se mue en désir, celui-ci en demande,
celle-ci en produits satisfaisant la demande, etc. Ainsi, dans notre monde
replet, s'illimite la faim de nouvelles consommations.
Pourtant,
si elle paraît ainsi ne surgir de rien sinon d'un jeu de signes[26],
cette économie est bien matérielle, et le mode de vie qu'elle mondialise exerce
des effets croissants, non moins par impact sur les écosystèmes que par
uniformisation des cultures. Il est clair par ailleurs que la métonymie qui la
rend possible suppose le corps humain, source inépuisable du désir qu'elle
industrialise.
Ainsi,
la mondialisation du marché revient-elle indéfiniment - mais par un détour
aujourd'hui aussi néfaste aux cultures qu'il l'est à la nature - au rapport de
notre corps avec l'environnement, et de notre personne avec autrui. C'est là en
effet la base, la terre, le sujet de notre monde. Alors, pourquoi ne pas
reconnaître que c'est par là - c'est-à-dire par la vie, tant la mienne que
celle d'autrui et celle de la biosphère - que tout cela commence ? Parce que ce
monde qui repose sur le néant d'un jeu de signes, le prédicat qui le régit
(celui du libéralisme de marché, théorisé par l'orthodoxie néo-classique en
économie) s'est donné pour paradigme non point la vie, et moins encore la
complexité de l'écoumène, mais le fantasme d'un modèle mécanique. Ce modèle,
aujourd'hui, s'est adjoint les dernières trouvailles de la cybernétique, voire
de la biologie moléculaire ; en quoi l'on peut parler du modèle de Cyborg[27]. Or aussi perfectionné soit-il, Cyborg
n'est autre que la réduction du vivant (et à plus forte raison de l'humain) au
principe d'identité qui gouverne les machines. Celles-ci, en effet, ne sont pas
suspectes de métaphores, c'est-à-dire de logique du prédicat : elles
fonctionnent par itération de l'identique. C'est ce qui justement permet
d'industrialiser, pour ceux qui en ont les moyens, la production des richesses
; il suffit de cacher qu'un monde n'est pas la Terre.
Maurepas, 14 octobre 2002.
[1] Voir Paul CLAVIER, Le concept de monde, Paris, Presses universitaires de France, 2000,
et pour un panorama contemporain le
volume Le monde de la revue annuelle Le temps de la réflexion, X, Paris,
Gallimard, 1989.
[2] Question traitée dans les Principia philosophiae, 1644.
[3] Ce renversement de perspective est
l'objet de Sein und Zeit (Être et temps, 1927).
[4] Selon l'expression imagée du physicien
américain John Wheeler, cité p. 829 dans Michel SERRES et Layla FAROUKI (dir.) Le Trésor. Dictionnaire des sciences,
Paris, Flammarion, 1997.
[5] Ce terme d'historial est utilisé dans la philosophie francophone, par
distinction avec historique, pour
rendre la différence établie par Heidegger entre geschichtlich (relatif au temps concret de l'existence historique)
et historisch (relatif au temps
abstrait de la science historiographique).
[6] Heidegger a développé ces conceptions
dans des écrits tels que Bauen, wohnen,
denken (Bâtir, habiter, penser,
1951) ou Die Kunst und der Raum (L'Art et l'espace, 1969). Pour une vue
d'ensemble, v. Jacques DEWITTE, Monde et espace : la question de la spatialité
chez Heidegger, p. 201-219 dans le collectif Le Temps et l'espace, Bruxelles, Ousia, 1992.
[7] Pierre MERLIN, L'Aménagement du territoire, Paris, Presses universitaires de
France, 2002, p. 361.
[8] Et pas seulement de « démagification » (Entzauberung) ou de « démondanisation »
(Entweltlichung), comme l'ont pensé
Weber et Heidegger ; car ce sont également les fondements du système dans la
nature qui sont bafoués : il est insoutenable aussi bien écologiquement que
moralement. Pour un tableau imagé de cette insoutenabilité, v. Anne-Marie
SACQUET, Atlas mondial du développement
durable. Concilier économie, social, environnement, Paris, Autrement, 2002.
Pour une confrontation de points de vue plus divers, v. GERM (Groupe d'études
et de recherches sur les mondialisations), Dictionnaire
critique de la mondialisation, Paris, Le Pré aux Clercs, 2002.
[9] Voir par exemple Alexandros-Ph.
LAGOPOULOS, Urbanisme et sémiotique dans
les sociétés préindustrielles, Paris, Anthropos, 1995.
[10] Dans le cas de Rome, ces rites sont
décrits par Lagopoulos p. 305 sqq.
[11] Rappelons que mundus et kosmos ont
fondamentalement le même sens de mise en ordre de la nature (d'où le sens
d'univers, dont nous avons gardé cosmos)
comme des comportements humains (d'où le sens de parure et de propreté, dont
nous avons gardé cosmétique).
[12] Texte repris p. 13-98 dans Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege, 1945), Paris, Gallimard, 1962.
Traduction de Wolfgang Brokmeier.
[13] (Note d'A.B) Mot-à-mot : le monde (Welt) mondise (weltet). Pour comprendre ce weltet,
et la traduction qu'en donne Brokmeier, on se reportera au sens étymologique de
mundus et de kosmos (v. ci-dessus, note 11).
[14] (Note d'A.B) Ce qui est dire que le monde ne relève
pas de l'extensio cartésienne.
[15] V. Reinhard MAY, Ex oriente lux : Heideggers Werk unter
ostasiatischem Einfluss, Stuttgart, Steiner Verlag, 1989. Traduction
anglaise, par Graham Parkes : Heidegger's
hidden sources. East Asian influences on his work, Londres et New-York,
Routledge, 1996.
[16] À ce sujet, v. Robert BLANCHÉ et Jacques
DUBUCS, La Logique et son histoire,
Paris, Armand Colin, 1996 (1970), p. 35 : « [Pour Aristote] un prédicat n'a pas
proprement d'existence, il n'est pas un être, mais il présuppose des existants
desquels il puisse être prédiqué et qui, dans une proposition, joueront le rôle
de sujets, hupokeimena. […] Le sujet
doit en effet y être entendu comme une substance ».
[17] Oratores
attici, 78.
[18] Timée,
92 c. Traduction Albert Rivaud, Paris, Les Belles Lettres, 1985 (1925), p. 228.
[19] Renvoyons sur ce point à André
LEROI-GOURHAN, Le Geste et la parole,
Paris, Albin Michel, 2 vol., 1964. J'ai parlé de « métaphore première », entre
autres dans L'Art, et la terre sous le ciel,
Art press, spécial 22 Écosystèmes du
monde de l'art (2001), p. 8-12, en m'inspirant sur le plan phylogénétique
et ontologique de la notion de primary
metaphor qu'emploient sur le plan cognitif George LAKOFF et Mark JOHNSON, Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to Western thought, New-York, Basic Books,
1999. Je suis par ailleurs
redevable à ces deux auteurs de la conviction que nos concepts les plus
abstraits non seulement dérivent d'images concrètes, mais que leur sens
continue de supposer cette concrétude, qui engage notre corps dans l'écoumène
(sur cette notion, v. plus bas, note 22). Ainsi, la métaphore première dont je
parle ici est ancrée par la phylogénèse dans la morphologie et la physiologie
mêmes du corps humain, et elle se répète en chaque petit enfant qui commence à
marcher tout en commençant à parler et à construire des choses.
[20] Pour un panorama sur cette question en
langue française, v. Augustin BERQUE et Philippe NYS (dir.) Logique du lieu et œuvre humaine,
Bruxelles, Ousia, 1997 ; et Augustin BERQUE (dir.), Logique du lieu et dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia, 2
vol., 2000. J'ai précisé mes propres vues dans deux chapitres de Livia MONNET
(dir.) Approches critiques de la pensée
japonaise du XXe siècle, Montréal, Presses de l'Université de
Montréal, 2001 : « La logique du lieu dépasse-t-elle la modernité ? », p.
41-51, et « Du prédicat sans base : entre mundus
et baburu, la modernité », p. 51-61.
Les deux œuvres de Nishida principalement concernées sont Basho (1926) et Bashoteki
ronri to shûkyôteki sekaikan (1945), respectivement recueillis dans les
tomes IV et XI de Nishida Kitarô zenshû,
Tokyo, Iwanami shoten, 1966 (ci-dessous NKZ).
[21] L'expression hakkô ichiu était le leitmotiv soutenant la politique d'expansion
japonaise avant la défaite de 1945. Cela visait d'abord la « sphère de
co-prospérité de la Grande Asie de l'Est » (Dai
Tô-A kyôei-ken), mais en puissance également le monde entier. Les deux
sinogrammes de hakkô (« huit
directions »), dans le Nihon shoki (Annales du Japon, compilées au VIIIe
siècle), sont lus amenoshita («
sous-le-ciel »), mot qui, comme son modèle le tianxia des Chinois, signifie à la fois l'empire et le monde. Telle
est également la signification de la lecture chinoise des deux mêmes
sinogrammes, bahong. Il s'agit
originellement d'une métonymie, le sens premier de hong étant celui de cordon (d'une coiffure, en particulier d'un
souverain ; d'où le sens de direction). Sur la signification du slogan hakkô ichiu pour l'ultranationalisme
nippon et son rapport avec les positions politiques de Nishida, on lira Pierre
LAVELLE, Nishida, l'école de Kyôto et l'ultranationalisme, Revue philosophique de Louvain, XCXII, 4 (nov. 1994) ; ainsi que,
pour une confrontation de points de vue divers, James W. HEISIG et John C.
MARALDO (dir.) Rude awakenings. Zen, the
Kyoto school, and the question of nationalism, Honolulu, Hawaii University Press, 1994. Si toutefois ces études éclairent les
positions politiques de Nishida, elles n'établissent pas le lien entre ces
positions et le noyau de sa théorie philosophique ; or ce lien lui est
consubstantiel, comme j'ai tenté de le montrer dans mes articles d'Approches critiques de la pensée japonaise
du XXe siècle (v. plus haut, note 20) et dans Écoumène (v. plus bas, note 22).
[22] L'écoumène - l'habiter humain sur terre,
autrement dit la relation concrète (sentie, pensée, dite, faite),
onto-géographique, de l'humanité à l'étendue terrestre - exprimant dans
l'espace, et l'histoire dans le temps, la prédication de la Terre en monde par
l'existence humaine. Cette relation peut se symboliser par la formule S/P, dans laquelle S = sujet (i.e. la Terre) et P
= prédicat (i.e. un monde). À une autre échelle, cette relation est un milieu
humain : la relation d'une société à son environnement. Sur ces questions, v.
Augustin BERQUE, Écoumène. Introduction à
l'étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000. Rappelons que le terme écoumène vient du grec oikoumenê (gê), « (terre) habitée ».
[23] Ce qui est le sens, par exemple, d'Inuit, Ainu, Anishinabe, Purepecha, etc.
[24] Comme il ressort notamment de l'usage
sempiternel, dans les textes de Nishida, d'une formule comme ichi soku ta, ta soku ichi (« l'un c'est
le multiple, le multiple c'est l'un »). Pour chargée de symbolisme qu'elle
soit, cette formule est aussi, au pied de la lettre, la négation radicale de
tout rapport d'échelle. J'ai développé cette question dans le chap. II d'Écoumène, op. cit. Si la logique
du prédicat n'a rien à voir avec l'échelle, c'est parce qu'elle est
foncièrement de nature métaphorique : prédiquer, autrement dit établir que S = P, c'est nier le principe d'identité
(dans lequel il ne peut y avoir que S = S,
ou bien P = P) ; et la métaphore,
logique du symbole, ne connaît ni la mesure ni l'échelle. Alors, à quoi
sert-elle donc ? À permettre la représentation, dans laquelle un signe peut
tenir lieu de son référent, alors qu'il n'est pas ce référent. Ce « tenir lieu
», ce n'est autre que la logique du lieu (ou logique du prédicat), qui permet
le déploiement de la Terre en un monde alors que celui-ci n'est pas son
référent (la Terre) ni même ne le cartographie (i.e. la carte n'est pas le
territoire, ce qui encore supposerait la mesure et l'échelle). Dans la logique
du lieu, celle du symbole et du langage, il y a bien représentation de A par
non-A, ce qui contrevient radicalement au principe d'identité. Là gît
l'incompatibilité entre la mondanité humaine et la science moderne, qui repose
au contraire sur le principe d'identité (la logique du sujet) et la mesure du
rapport mathématique entre les identités.
[25] L'empreinte
écologique est définie comme suit par l'inventeur de cette notion, William
Rees : « L'analyse de l'empreinte écologique [ecological footprint] est un outil comptable qui nous permet
d'évaluer la consommation des ressources et les besoins d'absorption des
déchets d'une population humaine ou d'une économie données, en termes de
superficie correspondante de sol productif » (Mathis WACKERNAGEL et William
REES, Notre empreinte écologique,
Montréal, Éditions Écosociété, 1999 [Our
ecological footprint : reducing human impact on the Earth, 1996], p. 29).
En ce sens, la société nord-américaine ponctionne les ressources de la
biosphère très au delà de la capacité biologique de celle-ci. Du reste, il est
clair depuis longtemps que, si tous les peuples de la planète adoptaient l'American way of life, ces ressources
seraient non seulement insuffisantes, mais même, pour beaucoup,
irrémédiablement détruites (la surpêche d'aujourd'hui tue la pêche de demain),
conduisant donc à la décimation de l'humanité. À l'absurdité suicidaire d'une
mondialisation qui tend à universaliser ce mode de vie, se joint donc le
cynisme de cette contradiction interne : pour que progresse le système de la
mondialisation, il faut absolument (c'est une question de vie ou de mort) que
ce système exclue de ses bénéfices la plus grande partie de l'humanité. Plus
clairement encore : il faut que plus en bénéficient les riches, moins en
bénéficient les pauvres. Bien évidemment, ledit système forclôt (refuse de
reconnaître) cette logique, qui est non seulement inacceptable moralement, mais
en outre écologiquement destructrice, puisqu'on sait bien que plus les gens
sont pauvres, moins ils sont en mesure de respecter les cycles de
renouvellement des ressources de la biosphère. Quelques approximations
statistiques feront sentir cette logique insoutenable de notre monde :
aujourd'hui, les 250 personnages les plus riches gagnent davantage que la
moitié la plus pauvre de l'humanité ; rapport qui ne fait que s'aggraver :
pour 15 euros prêtés à l'Afrique,
celle-ci doit en rembourser 20 ; un Nord-Américain prélève 600 litres d'eau par
jour, un Européen 250, un Africain 30. Etc.
[26] En l'occurrence l'effet de la pub selon
lequel la métonymie parure du corps
désirable = le corps désirable, qui n'est autre que la prédication S est P. Rappelons que kosmos (ainsi que mundus) a aussi le sens de parure. Ladite prédication peut donc
aussi bien se lire Terre (S) est monde (P), ce qui justifie la
subsomption de l'universel (la Terre) sous le singulier (un monde, le nôtre).
Autrement dit, de prétendre que parure
est substance. Telle est la logique mondaine de la pub, qui dans son
principe soutient notre monde sur le néant, et dans la pratique sur la négation
d'autrui, l'appauvrissement des pauvres et la destruction de la biosphère.
[27] Quoiqu'on puisse parvenir aux mêmes
conclusions par un raisonnement d'ordre géographique et ontologique [v. à ce
sujet mes articles On the Chinese origins of Cyborg's hermitage in the absolute
market, p. 26-32 dans Gijs WALLIES DE VRIES et Wim NIJENHUIS (dir.), The global city and the territory. History,
theory, critique, Eindhoven, Eindhoven University of Technology, 2001 ; et
L'habitat insoutenable. Recherche sur
l'histoire de la désurbanité, L'espace
géographique, vol. XXXI, 3, 2002, p. 241-251], je me réfère ici plus
particulièrement à Phillip MIROWSKI, Machine
dreams. Economics becomes a Cyborg science, Cambridge, Cambridge University
Press, 2002. Celui-ci a résumé ses idées, qu'il a développées dans une suite
d'ouvrages sur l'histoire de la pensée économique moderne, dans un dialogue
avec Carlos Mallorquín, Descifrando la economía de los sueños, Este país, 137, août 2002, p. 39-53. Les
travaux de Mirowski ont montré que la pensée économique néo-classique s'est
moulée sur un modèle physicien, et ce notamment parce qu'elle a été guidée par
les travaux de gens venus des sciences de l'ingénieur (notamment à la faveur
des programmes de recherche subventionnés par le Pentagone au lendemain de la
deuxième guerre mondiale), ignorant et négligeant l'histoire de l'économie
elle-même (qui par nature n'est pas une science de la Terre, ni même de la
biosphère, mais une science de la Terre prédiquée en monde par la vie et par
les cultures humaines, i.e. une science de l'écoumène. On se souviendra du
reste que l'étymologie d'éco- est oikos). Ce modèle fut d'abord simplement
mécanique, puis thermodynamique, puis cybernétique, et se mâtine aujourd'hui de
biologie ; ce qui ne change rien au principe de réduction qui le fonde, et qui
consiste à faire passer une logique du prédicat pour une logique du sujet.
Note sur l'auteur : né en 1942 à Rabat, géographe, orientaliste et philosophe, Augustin Berque est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Membre de l’Académie européenne, il a été en 2009 le premier occidental à recevoir le Grand Prix de Fukuoka pour les cultures d’Asie.
 |
| Breath of the Earth, Bang, Hai Ja (1994) (source) |
