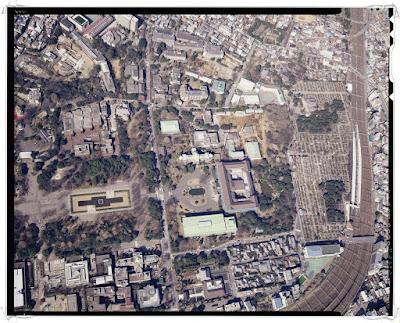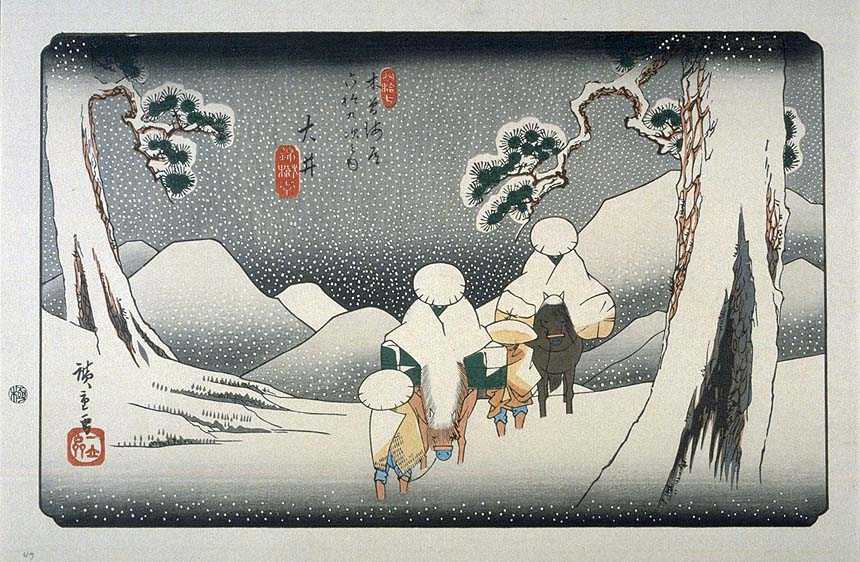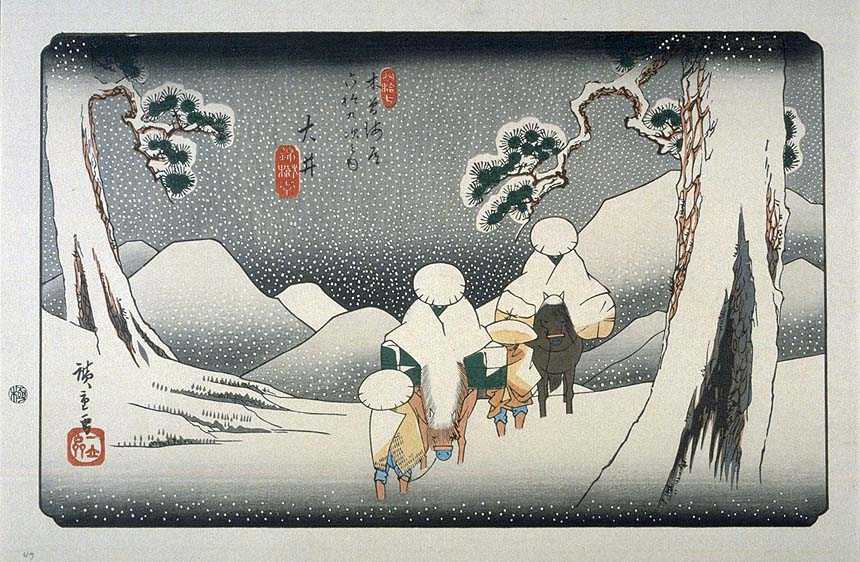 |
Sur mon chapeau
La neige me paraît légère
Car elle est mienne
Haïku de Nagata Koi (1900-1997)
Estampe d'Hiroshige, (69ème Station de Kisokaido, 1834)
(source) |
La Maison de la poésie de Nantes, Poésies et écologies, Lieu unique, 28 novembre 2015
La perception du milieu nippon au prisme du haïku
Augustin BERQUE
1. De quel point de vue ?
Je ne
vous parlerai pas en spécialiste de la littérature japonaise, ce que je ne suis
pas, ni en poéticien, bien que j’aie commis l’an dernier un livre intitulé Poétique de la Terre[1] ; mais il
s’agissait en réalité d’une poïétique
de la Terre, c’est-à-dire d’une analyse de la force créatrice de cette planète dont
l’évolution, en quelque quatre milliards d’années, est passée, en créant
d’abord la vie, d’un simple état physico-chimique à l’état
bio-physico-chimique, c’est-à-dire écologique, celui de notre biosphère, pour
accéder enfin, en créant l’humanité, à l’état éco-techno-symbolique, celui de
notre écoumène, c’est-à-dire l’ensemble des milieux humains, ou la relation de l’humanité
avec la Terre.